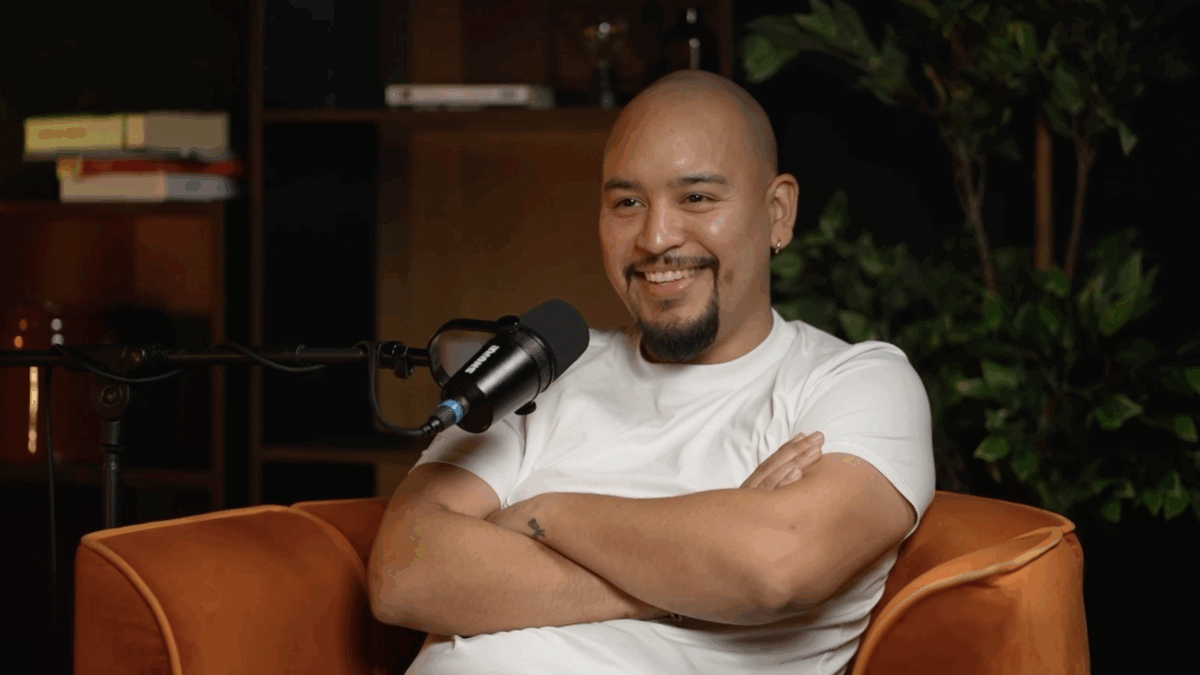La recrudescence du chikungunya et l’expansion du moustique tigre en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins imposent une vigilance accrue. Comprendre les modes de transmission, les zones d’émergence et les risques sanitaires associés est essentiel pour adapter les stratégies de prévention et renforcer l’efficacité des interventions.
Sommaire
Le chikungunya : une arbovirose émergente au potentiel invalidant
D’abord cantonné aux forêts tropicales africaines, où il circulait entre primates, oiseaux et moustiques sylvatiques, le virus du chikungunya a franchi une étape décisive dans son évolution avec l’adaptation de deux espèces désormais bien connues : Aedes aegypti et Aedes albopictus. Ces moustiques, fortement anthropophiles, sont devenus les vecteurs principaux de cette maladie chez l’être humain.
Transmis exclusivement par la piqûre d’un moustique infecté – femelle uniquement – le chikungunya n’est ni une zoonose, ni une maladie contagieuse entre humains, sauf dans des cas très particuliers (transfusions, greffes ou transmission mère-enfant à l’accouchement). Après une incubation de 2 à 12 jours, les symptômes apparaissent brutalement : forte fièvre, douleurs articulaires aiguës, maux de tête, fatigue intense, troubles digestifs ou encore éruptions cutanées.
Si la plupart des patients se rétablissent en quelques semaines, près de 40 % d’entre eux développent une forme chronique, marquée par des douleurs articulaires persistantes pouvant durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Chez les populations à risque – personnes âgées, nouveau-nés ou patients souffrant de comorbidités – des complications graves, notamment neurologiques, hépatiques ou cardiaques, peuvent survenir.
Le chikungunya, c’est vraiment une maladie handicapante, qui fatigue énormément et qui bloque beaucoup en termes de mobilité.
Grégory Peyré, formateur IZIPest
Un constat clinique qui souligne la nécessité d’agir en amont, tant sur le plan de la prévention que de la surveillance vectorielle.
Aujourd’hui, le virus est présent dans plus de 110 pays, et le moustique tigre, implanté dans 80 départements français, représente un vecteur redoutable en cas d’importation virale. Dans ce contexte, chaque piqûre évitable devient une mesure de prévention à part entière.
Une dynamique épidémique préoccupante en 2025 : La Réunion, Mayotte et la métropole sous tension
L’année 2025 marque un tournant dans la circulation du chikungunya sur les territoires français. À La Réunion, le virus a connu une flambée soudaine et massive dès le premier trimestre. À son pic, en semaine 13, plus de 6 000 cas confirmés ont été recensés, accompagnés d’un nombre croissant d’hospitalisations, essentiellement parmi les publics fragiles (personnes âgées, nourrissons ou patients avec comorbidités).
Même si on a peu d’impact en termes d’hospitalisations, la diffusion du virus est impressionnante, et notre système de santé reste sous tension.
Arnaud Gamracy, formateur IZIPest
Alors que l’épidémie semble amorcer un déclin à La Réunion, la situation est inverse à Mayotte, où l’on observe une progression rapide. En l’espace d’une semaine (entre S20 et S21), les cas ont bondi de 42 %, avec des foyers bien identifiés dans plusieurs communes. Le moustique tigre, fortement sédentaire, favorise une propagation locale intense, aggravée par des conditions sanitaires parfois précaires.
En parallèle, la métropole enregistre une augmentation notable des cas importés. La grande majorité d’entre eux (plus de 89 %) proviennent de La Réunion. Le tourisme agit ici comme principal vecteur d’introduction du virus sur un territoire où Aedes albopictus est désormais implanté dans 80 départements sur 96. Ce contexte crée une situation propice à l’émergence de foyers autochtones, en particulier durant la saison estivale.
Ainsi, la convergence entre épidémies ultramarines, mobilité humaine et présence du vecteur en métropole constitue un cocktail épidémiologique à haut risque, qui impose une vigilance renforcée de la part des professionnels de terrain.
Un virus qui repose entièrement sur son vecteur : le moustique
Le chikungunya est une arbovirose dont la transmission repose exclusivement sur l’activité vectorielle des moustiques du genre Aedes, notamment Aedes aegypti et Aedes albopictus, tous deux fortement anthropophiles et bien implantés en milieu urbain.
Ce n’est qu’après avoir piqué un hôte infecté que la femelle moustique devient porteuse du virus. Celui-ci se réplique alors dans son organisme et est transmis lors d’une piqûre ultérieure, par l’intermédiaire de sa salive. Comme le rappelle un intervenant du webinaire : « Pour que le virus soit actif, il doit impérativement passer par le moustique. Ce n’est pas un simple transporteur, c’est un véritable vecteur biologique. »
Cette dépendance à un vecteur actif explique pourquoi le chikungunya ne se transmet ni par contact direct, ni par l’air, et pourquoi chaque piqûre évitable constitue une action de prévention. À noter également que les personnes infectées peuvent, durant quelques jours après l’apparition des symptômes, servir de réservoir au virus : si elles se font piquer, un moustique sain peut devenir vecteur à son tour.
La lutte contre le chikungunya passe donc inévitablement par la réduction des populations de moustiques vecteurs. Il s’agit là du levier le plus stratégique pour limiter la propagation du virus.
Symptômes, formes chroniques et complications du chikungunya
Le chikungunya se manifeste généralement par une fièvre brutale dépassant les 38,5 °C, accompagnée de douleurs articulaires intenses, de courbatures, de céphalées, d’une fatigue marquée et, dans certains cas, d’éruptions cutanées, de conjonctivites ou de troubles digestifs. Ces symptômes apparaissent après une période d’incubation variable, généralement comprise entre 4 et 7 jours.
Tous les individus infectés ne présentent pas nécessairement de signes cliniques : environ 50 % des cas seraient asymptomatiques, bien que ce taux reste encore sujet à débat.
Des formes chroniques invalidantes
Chez près de 40 % des patients symptomatiques, les douleurs articulaires persistent au-delà de 3 mois. On parle alors de forme chronique.
Dans certains cas, ces douleurs peuvent durer de un à trois ans, voire davantage. Des cas isolés ont même été rapportés avec des symptômes persistants jusqu’à 6 ans. Le terme « maladie handicapante » n’est pas galvaudé :
« Les douleurs articulaires peuvent bloquer les mouvements pendant des mois. On est face à une fatigue profonde, invalidante. » — ont souligné les intervenants.
Outre ces formes prolongées, le chikungunya peut entraîner des complications sévères, bien que rares (1 à 2 % des cas). Elles concernent surtout les nouveau-nés, les personnes âgées ou immunodéprimées, et peuvent affecter le système nerveux, le cœur, le foie, les yeux ou la peau.
Enfin, en l’absence de traitement antiviral spécifique, la prise en charge reste purement symptomatique : antalgiques, repos, séances de kinésithérapie, et éventuellement anti-inflammatoires sur avis médical. Les formes graves nécessitent une hospitalisation et une surveillance rapprochée.
Vaccins et prévention pharmacologique : des avancées encore limitées
Face à l’ampleur croissante des épidémies, plusieurs candidats vaccins contre le chikungunya ont vu le jour. À ce jour, deux produits sont autorisés au niveau européen : IXCHIQ et VIMKUNYA. Toutefois, seul le vaccin IXCHIQ est actuellement disponible en France.
Une couverture partielle, des restrictions d’usage
Le vaccin IXCHIQ est destiné aux adultes âgés de 18 à 64 ans résidant ou se rendant dans des zones à risque. Depuis avril 2025, son utilisation est déconseillée chez les personnes de plus de 65 ans, en raison d’effets indésirables rapportés dans cette tranche d’âge.
Quant à VIMKUNYA, bien qu’autorisé au niveau européen, il n’est pas encore disponible en France. Son mode d’action distinct pourrait toutefois permettre, à terme, une immunisation plus large, notamment chez les personnes âgées, sous réserve de validation finale.
Une réponse limitée à une menace installée
Comme l’ont souligné les intervenants, ces vaccins ne sont pas encore déployés à grande échelle, et leur impact reste marginal face à la dynamique actuelle de propagation du virus. En l’état, la vaccination ne peut être envisagée que comme une mesure complémentaire, ciblée sur des publics bien identifiés.
En l’absence de traitement curatif et d’immunisation massive, la prévention vectorielle demeure le levier prioritaire pour limiter la transmission : élimination des gîtes larvaires, sensibilisation des populations, et protection individuelle contre les piqûres restent les piliers de toute stratégie efficace
Vécu et sensibilisation : le témoignage d’Angéline Rossi face au chikungunya
Au-delà des chiffres et des mécanismes biologiques, le webinaire Izipest a donné la parole à Angéline Rossi, ancienne patiente, touchée par le chikungunya lors d’un séjour à La Réunion. Son témoignage, à la fois sobre et saisissant, a permis de mettre en lumière les répercussions concrètes de cette maladie sur le quotidien.
Elle décrit l’apparition brutale des symptômes : fièvre intense, douleurs articulaires invalidantes, épuisement physique. Mais surtout, elle insiste sur la durée et l’intensité des séquelles. Des mois après l’infection, les douleurs persistent. Les gestes simples deviennent difficiles, la fatigue est constante, et la reprise d’une vie normale s’effectue lentement, parfois au prix d’un suivi médical et de séances de kinésithérapie régulières.
Ce retour d’expérience a suscité de nombreuses réactions parmi les participants, en résonance avec un constat partagé dans le domaine de la lutte antiparasitaire :
« On prend vraiment conscience de l’impact d’un nuisible ou d’une maladie quand on l’a vécue. »
Ce témoignage vient rappeler que derrière chaque cas, chaque graphique, se cache une réalité vécue — souvent lourde — qui justifie pleinement les efforts de prévention, de surveillance et d’information que doivent mener les professionnels du secteur.
Le chikungunya s’impose comme une menace entomologique croissante, portée par l’expansion du moustique tigre et la mobilité internationale. Entre formes chroniques invalidantes, absence de traitement curatif et couverture vaccinale encore restreinte, la prévention vectorielle reste la clé. Comprendre le virus, ses dynamiques, et ses impacts concrets est indispensable pour adapter les pratiques de terrain et anticiper les risques.
Source : Webinaire IZIPest
ÉCRIVEZ-NOUS
Avez-vous des nouvelles sur le secteur 3D, que vous souhaitez partager avec nous?