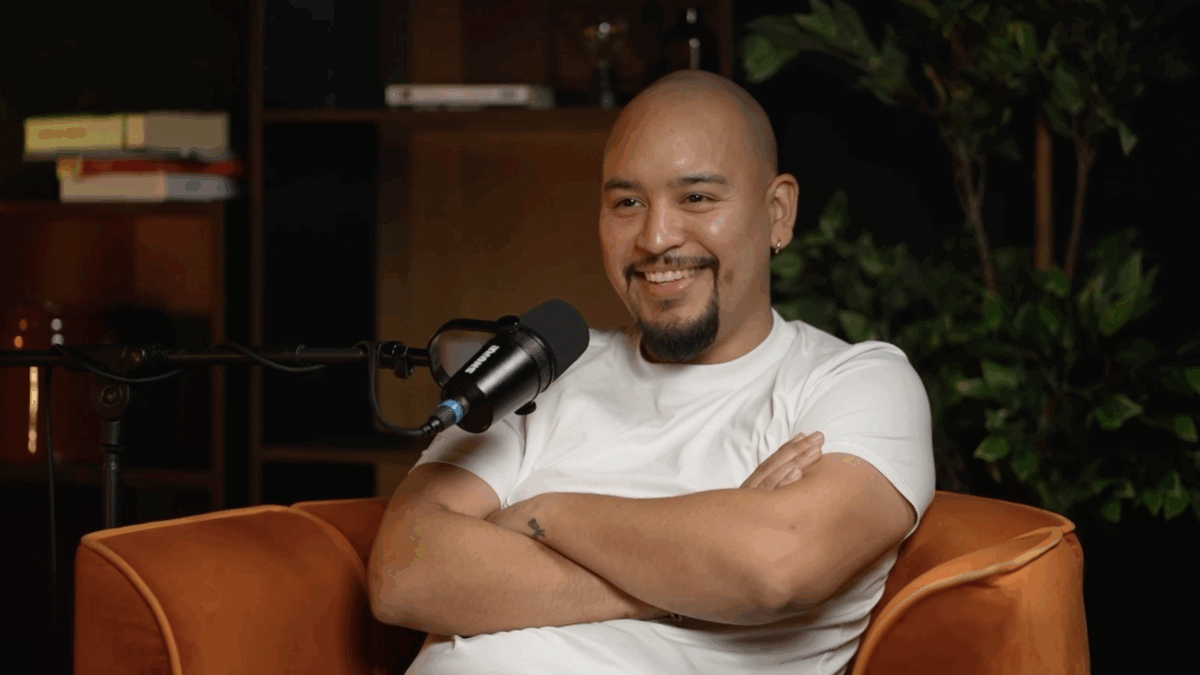Tiques : comprendre les risques pour mieux prévenir

La présence des tiques en France connaît une progression préoccupante, avec des conséquences directes sur la santé humaine et animale. Selon des données partagées lors du webinaire IziPest sur les tiques, près de 80 % des tiques analysées portent au moins un agent pathogène, et 80 à 100 cas de maladie de Lyme sont recensés chaque année pour 100 000 habitants. Face à ces chiffres, la lutte contre les tiques devient un enjeu majeur.
Sommaire
Quels facteurs expliquent l’augmentation des risques liés aux tiques ?
L’intensification des risques liés aux tiques s’explique par une combinaison de facteurs environnementaux, biologiques et humains :
- Climat plus favorable : des hivers plus doux favorisent leur survie et prolongent leurs cycles d’activité.
- Milieux propices : la diminution du débroussaillage et l’accumulation de bois mort créent des habitats idéaux.
- Multiplication des hôtes : l’augmentation des populations de cervidés, rongeurs et animaux domestiques favorise la prolifération.
- Exposition humaine accrue : travaux forestiers, chantiers, loisirs, interventions techniques… les occasions de contact se multiplient.
Pour les acteurs de la gestion des nuisibles, cette évolution implique :
- une hausse significative des demandes d’interventions dans les zones à risque,
- l’adaptation des protocoles d’inspection et de prévention,
- et un renforcement de la formation des équipes afin de protéger les techniciens et leurs clients.
Quelles espèces de tiques surveiller et comment les identifier ?
La lutte contre les tiques nécessite une bonne connaissance des espèces présentes en France et de leurs comportements. Trois principales sont particulièrement surveillées :
- Ixodes ricinus (tique du chevreuil) : la plus répandue, présente dans les forêts, parcs et jardins..
- Dermacentor reticulatus : fréquente dans les prairies et zones humides.
- Rhipicephalus sanguineus (tique du chien) : très présente en zones urbaines.
Comprendre leur cycle de vie
Avant d’élaborer toute stratégie de lutte, il est essentiel de maîtriser le fonctionnement biologique des tiques. Leur cycle de vie, divisé en trois stades, conditionne les périodes d’activité et les moments de vulnérabilité.
- 3 stades principaux : larve – nymphe – adulte.
- Chaque stade nécessite un repas de sang pour évoluer.
- Les tiques repèrent leurs hôtes grâce à la chaleur corporelle et au dioxyde de carbone.
Bien connaître ces espèces et leur cycle biologique permet d’anticiper les périodes de risque, de cibler les zones prioritaires et de renforcer l’efficacité des actions de prévention.
Les principales maladies transmises par les tiques
Les tiques peuvent être vectrices de plusieurs pathologies, dont certaines connaissent une progression préoccupante :
- La maladie de Lyme
C’est la plus fréquente. Provoquée par la bactérie Borrelia burgdorferi, elle se manifeste par différents symptômes : apparition d’une tache rouge autour de la piqûre, douleurs articulaires, fatigue persistante. Le diagnostic reste parfois difficile. - L’encéphalite à tiques
Moins courante mais potentiellement grave, cette infection virale peut toucher le système nerveux central. - Babésiose et anaplasmose
Deux maladies émergentes qui touchent surtout les animaux, mais qui peuvent également affecter l’humain.
Ces pathologies rappellent l’importance de renforcer les mesures de prévention et les stratégies de surveillance pour améliorer l’efficacité de la lutte contre les tiques.
Prévention et bonnes pratiques dans la lutte contre les tiques
La lutte contre les tiques repose sur une approche intégrée combinant surveillance, réduction des risques environnementaux, protection individuelle et formation des équipes. Pour les professionnels de la gestion des nuisibles, l’enjeu n’est pas seulement sanitaire : il engage aussi la responsabilité juridique et la qualité des prestations.
1. Surveillance et cartographie des zones à risque
Avant d’intervenir, il est essentiel de localiser les zones les plus exposées. Une veille active permet d’agir au bon moment et au bon endroit.
- Identifier les secteurs à forte densité de tiques (zones boisées, parcs, jardins publics, chantiers).
- Mettre en place des protocoles de suivi saisonnier pour détecter les pics d’activité.
- S’appuyer sur les données des ARS et des retours de terrain pour prioriser les interventions.
2. Protocoles d’intervention et choix des traitements
Une intervention efficace repose sur des traitements adaptés au contexte. Cela implique de bien connaître les espèces ciblées et de privilégier des méthodes durables avant l’usage de biocides.
- Adapter les méthodes de lutte en fonction de l’espèce dominante et de son cycle biologique.
- Privilégier les mesures mécaniques et environnementales (débroussaillage, nettoyage des zones à risque) avant d’avoir recours aux biocides.
- Sécuriser les zones traitées pour limiter l’exposition du public et des animaux domestiques.
3. Protection individuelle et gestion des équipes
Protéger les techniciens est un impératif opérationnel. Cela passe par une organisation rigoureuse et des équipements adaptés, à travers les mesures suivantes :
- Former les techniciens à la détection précoce des tiques sur la peau et les vêtements.
- Fournir des EPI adaptés : vêtements longs, répulsifs validés, gants, tire-tiques.
- Mettre en place des procédures de signalement en cas de piqûre ou de suspicion d’exposition.
4. Information et sensibilisation des clients
Les bonnes pratiques passent aussi par la transmission de l’information au client. Voici comment renforcer leur implication dans la prévention :
- Expliquer les risques sanitaires liés aux tiques et les bonnes pratiques d’auto-inspection.
- Proposer des plans de prévention personnalisés selon les zones d’intervention.
- Fournir des supports pédagogiques pour améliorer l’efficacité des mesures collectives.
La lutte contre les tiques nécessite une prévention ciblée et des actions coordonnées. En renforçant la surveillance, la formation des équipes et la sensibilisation des clients, les professionnels peuvent limiter les risques sanitaires et améliorer l’efficacité de leurs interventions.
Source : Synthèse issue du Webinaire IziPest du 26/08/2025
ÉCRIVEZ-NOUS
Avez-vous des nouvelles sur le secteur 3D, que vous souhaitez partager avec nous?
communication@hamelin.info