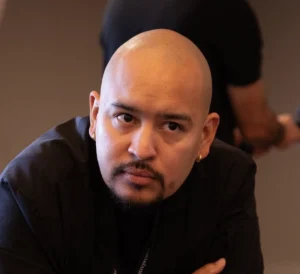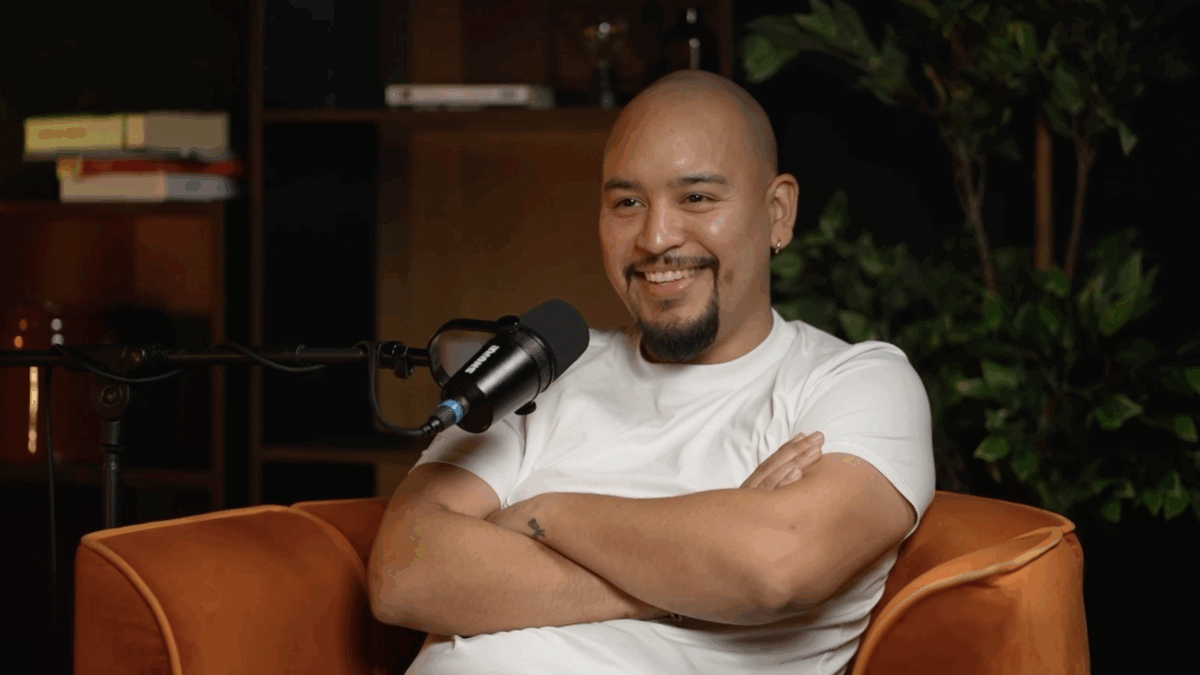Carboglace : dossier brûlant

Depuis quelques années, les professionnels de la filière 3D, et en particulier les spécialistes de la dératisation, s’écharpent sur le sujet. Dans le coin gauche, les partisans de la carboglace défendent les avantages écologiques de cette solution. Dans le coin droit, les détracteurs de la neige carbonique soulignent les risques d’une pratique qui n’est pas officiellement reconnue par les autorités. Let’s get ready to rumble.
Sommaire
Qu’est-ce que la carboglace ? Origine et usages
D’où vient la carboglace ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est urgent de faire un petit détour historique.
Une découverte française à l’origine de la carboglace
Si la carboglace a été d’abord commercialisée aux Etats-Unis, dans les années 1920, notamment pour les extincteurs puis pour la conservation des crèmes glacées et des aliments, le procédé chimique a, lui, été découvert par un Français.
En 1834, le chimiste Adrien Jean Pierre Thilorier a conçu et assemblé un appareil pour liquéfier du CO₂. Un an plus tard, en 1835, il a découvert en ouvrant un récipient pressurisé de gaz carbonique sous forme liquide que ce dernier, soumis à la pression atmosphérique, produisait de la « neige carbonique » quand il s’évaporait.
Carboglace et lutte contre les rongeurs : une alternative écologique ?
Comme son nom l’indique, la glace carbonique est produite à partir du dioxyde de carbone.
Un fonctionnement basé sur la sublimation du CO₂
Sous forme liquide, ce gaz est refroidi (en dessous de -78,5°C) jusqu’à obtenir une matière solide, ce qui permet de le transporter plus facilement. Or, au contact de la pression atmosphérique, le CO2 solide se transforme directement en vapeur par sublimation, sans passer par la phase liquide.
Bon à savoir : la glace carbonique disparait quand elle se réchauffe, sans laisser de résidus. C’est donc une technique neutre en carbone, respectueuse de l’environnement, car elle n’émet que le CO2 utilisé au départ comme sous-produit.
Des applications industrielles et médicales variées
Au fil des ans, la neige carbonique a vu se multiplier les cas d’usage. Aujourd’hui, elle est indispensable dans la restauration et la grande distribution pour maintenir la chaîne du froid.
Elle est également utilisée pour le nettoyage et décapage cryogénique des machines ou des surfaces. Dans les pompes funèbres, elle est très utile à la conservation des corps.
Les dermatologues y ont recours pour brûler les verrues et effacer certaines imperfections de la peau. La neige carbonique est également précieuse pour refroidir certains appareils électroniques ou composants d’ordinateurs ou, dans les travaux de construction, pour geler le sol et les conduites d’eau avant une intervention.
Pourquoi la carboglace reste un sujet controversé ?
Mais revenons à nos nuisibles. La carboglace est également le meilleur ennemi des rats.
Une méthode utilisée sur le terrain par certains opérateurs
À la tête de sa société Kosmos 3D, Kévin Granada Rios a recours à cette technique qui permet d’asphyxier les rongeurs dans leurs terriers sans laisser de résidus. « On l’utilise depuis plusieurs années pour d’excellents résultats », dit-il. Une solution qui, à première vue, semble idéale pour combattre les infestations de rongeurs dans les espaces verts.
Certaines collectivités ne s’y trompent pas et orientent leurs prestataires vers ce type de solutions alternatives. « On a adapté notre traitement à la demande de la ville de Saint-Ouen », confirme Kévin Granada Rios.
Il faut dire qu’en France, les rodonticides font l’objet de restrictions réglementaires, comme en témoigne l’interdiction de l’appâtage permanent, qui consistait à laisser de manière permanente des appâts rodonticides.
Des collectivités séduites par l’argument écologique
Dans le podcast « Rat : dégâts et débat » organisé par Hamelin Info (voir encadré), Dina Deffairi Saissac, conseillère municipale et territoriale à la Mairie de Saint-Ouen, se félicite d’avoir ajouté cette corde à son arc de solutions anti-rats, notamment pour les espaces verts.
En un an, le nombre de terriers sur la commune est passé de 208 à moins de 40 : « Sur les espaces verts où l’on introduit la carboneige, on referme le terrier, le rat meurt sous terre et se décompose nourrissant ainsi les massifs fleuris.
C’est écologique, pas chimique », apprécie-t-elle avant d’ajouter : « En tout cas, ça reste moins gênant et possiblement moins contaminant pour les enfants et les animaux de compagnie. Le rat meurt de façon quasi instantanée, contrairement aux produits chimiques où il est tenu d’ingérer une quantité minimum. »
Quels sont les risques liés à l’utilisation de la carboglace ?
Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Pas si sûr, car la carboglace n’a pas jamais fait l’objet d’une AMM ou Autorisation de Mise sur le Marché.
Interrogé par PROSANE, le syndicat de la profession, sur l’utilisation de la glace carbonique à des fins rodonticides, l’ANSES a freiné des quatre fers.
« Le CO2 généré in situ à partir de la carboglace n’a pas été soutenu dans le cadre de la réglementation biocide UE. Cette source de CO2 ne peut donc pas être utilisée à des fins biocides au niveau de l’Union, quel que soit que l’usage (et donc en tant que rodenticide TP14) », a estimé L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Une absence d’évaluation et des risques sanitaires
Dans le podcast cité plus haut, Gabrielle Cor de chez Liphatech rappelle ainsi que la carboglace est en pleine mutation réglementaire et doit obtenir l’approbation européenne.
Une reconnaissance réglementaire encore absente
Elle n’est toujours pas considérée comme biocide. Selon la loi, elle n’est donc pas applicable contre les rats. « C’est un détournement d’usage », s’étrangle Nicolas Didych, le directeur pédagogique d’IZIpest qui rappelle qu’il existe de nombreuses autres méthodes pour traiter des terriers, à l’instar des anticoagulants ou du furetage, une option ancestrale de lutte par prédation naturelle que nous avons exploré en détail dans Viva Protect n°2.
Le spécialiste dénonce l’absence d’évaluation : « On ne connaît pas les conditions de stockage, on n’a pas les conditions d’utilisation par terrier, on ne connaît pas les dosages », et craint les risques pour la santé des personnes : « Imaginez un type qui a un accident avec un véhicule rempli de carboglace et que celle-ci se propage dans le véhicule. Il risque l’intoxication au dioxyde de carbone. »
Des risques sanitaires liés à l’exposition au CO₂
En 2020, une étude de l’INRS(1) (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) a tenté de mesurer l’impact d’une exposition prolongée au CO2 sur les opérateurs amenés à manipuler de la carboglace pour conserver des greffons.
Ceux-ci se plaignaient de symptômes pouvant être liés à l’inhalation de CO2 : maux de tête, sensation de fatigue, picotements de la langue. L’Institut a conclu son étude en recommandant de limiter l’exposition au CO2.
« Même s’il est écologique, le produit n’est pas sans danger pour l’homme », assène Nicolas Didych. Quant à son efficacité, on peut se demander si elle est réelle ? « Si le produit était efficace, quelqu’un entamerait la procédure d’autorisation de mise sur le marché », conclut Nicolas Didych. Affaire à suivre.
(1) Manipulation de carboglace : mesure de l’exposition individuelle au CO2 à l’aide de détecteurs à lecture directe. GALLAND B.,GERARDIN K.,MONTA N.,CHEVALIER S.,JARRAYA M., Revue Hygiène et Sécurité au Travail, décembre 2020.
Auteur : Nicolas ZEISLER
Contributeurs :
Kévin Granada Rios – Kosmos 3D
Nicolas Didych – IZIpest
Source : Extrait du magazine Viva protect n.3 – Mars 2025
ÉCRIVEZ-NOUS
Avez-vous des nouvelles sur le secteur 3D, que vous souhaitez partager avec nous?
communication@hamelin.info